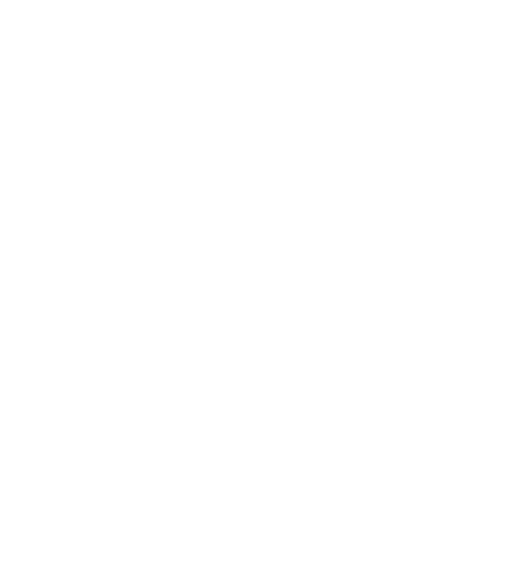«Nous avons l’immense chance de pouvoir travailler avec un chantier exceptionnel de fouilles archéologiques.»
Quatre questions à Christiane Twiehaus
L’histoire juive antique et médiévale s’écrit entre autres grâce aux découvertes archéologiques. À Bâle, on a découvert des pierres tombales datant des 13e et 14e siècles lors de la construction en 1937 de la Maison des collèges (Kollegienhaus) de l’Université de Bâle; elles sont exposées depuis 1966 dans la cour du musée – la plus ancienne aura 800 ans cette année. À Cologne, un quartier juif mis au jour va être inauguré prochainement comme musée. Il s’agit du projet d’exposition longtemps attendu sur la vie juive au Moyen Âge. Dr. Christiane Twiehaus du «MiQua – LVR-Musée juif dans le quartier archéologique de Cologne» a parlé avec Dr. Naomi Lubrich de ses recherches, de la vie des Juives et des Juifs au bord du Rhin, et des liens entre Cologne et Bâle.
Naomi Lubrich: Chère Christiane, nous attendons tous avec une grande impatience le «MiQua». Où en sont les travaux?
Christiane Twiehaus: Nous sommes en plein dedans! La construction du musée se déroule parallèlement aux préparatifs de la future exposition permanente, et parallèlement aux recherches qui s’y rattachent sur les plans archéologique, judaïque et historique. Nous aménageons pour cela un parcours de visite à travers 2000 ans d’histoire urbaine, sur une surface d’archéologie d’environ 6500 m2. En plus des découvertes romaines qui sont omniprésentes à Cologne, existait aussi ici, à savoir «au-dessus», le quartier juif médiéval.
NL: En tant que spécialiste du judaïsme, tu as exploité de nombreux documents. Que révèlent-ils sur la vie quotidienne des Juives et des Juifs de Cologne?
CT: Pour représenter l’histoire et la civilisation juives, je cherche des sources écrites hébraïques du Moyen Âge qui nous relatent la vie dans le quartier de Cologne du point de vue intrajuif. Si nous ne disposions pour ceci que des sources urbaines et chrétiennes, le récit serait très partial et se limiterait probablement à une juxtaposition de sauf-conduits et de titres de créance. Grâce aux écrits hébraïques, nous avons par exemple connaissance des règles alimentaires spécifiques, de l’installation d’un Érouv (délimitation d’un quartier juif), ou des traditions locales dans la synagogue. Mais des choses quotidiennes sont également transmises, comme par exemple la question juridique suivante: une poule tombe du haut d’un mur. Est-elle encore casher? En effet, la poule pourrait avoir des lésions internes. Et l’un des rabbins décide de manière très pragmatique qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
NL: Il y a eu une communauté juive à Bâle depuis le 12e siècle. Quels étaient les contacts avec Cologne, comment étaient les liens entre les communautés le long du Rhin?
CT: C’est une question passionnante! Et elle me rappelle la première grande exposition sur l’histoire et la civilisation juives au bord du Rhin, la «Monumenta Judaica», qui s’est tenue après la Shoah ici à Cologne en 1963 et 1964, et dans laquelle étaient également représentés d’importants judaïca de Bâle. Le Rhin a de tous temps été voie commerciale, artère culturelle et vitale. Par conséquent, des liaisons étroites ont existé ici entre les communautés, notamment dans les villes SchUM Spire, Worms et Mayence. Grâce à la bonne transmission à des particuliers, nous avons également connaissance par exemple d’un certain Salman de Bâle. Originaire de Cologne, il a vécu à partir de 1284 environ à Bâle, qu’il a de nouveau quittée quelques années plus tard pour retourner à Cologne après une halte à Mayence. Ici, il a été membre du Conseil des Juifs. C’était une figure illustre qui a exercé de hautes fonctions et qui possédait plusieurs maisons dans le quartier juif. Grâce à son testament, nous connaissons aussi un peu l’ameublement des maisons.
NL: Quelle question occupera le plus à l’avenir votre projet de musée?
CT: Nous avons l’immense chance de pouvoir travailler avec un chantier exceptionnel de fouilles archéologiques. À côté de questions telles que «Qu’est-ce qui est typiquement kölsch?», dans la liturgie ou la Halakha par exemple, il s’agit aussi de savoir comment était la vie normale de tous les jours: Quelles étaient les professions exercées par les Juives et les Juifs, comment étaient les échanges avec la population chrétienne, où se trouvaient les lieux de contact, comment était la cohabitation à tous les niveaux, que nous révèlent à ce sujet les découvertes archéologiques. Nous aimerions démontrer que la vie juive était une partie intégrante de Cologne et ne constituait pas un monde à part.
NL: Chère Christiane, nous sommes impatients! Merci beaucoup pour l’aperçu que tu nous as donné de ton travail.
rédigé le 09.09.2022
© Illustartion: Marva Gradwohl