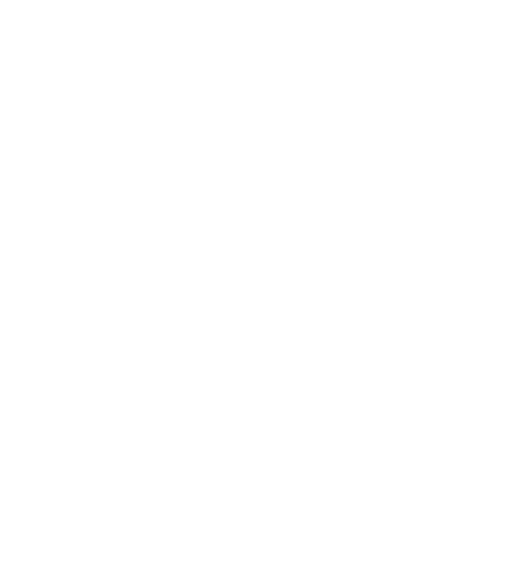«Il n’existe pas de définition unique du judaïsme.»
Quatre questions à Darja Pisetzki
Darja Alexandra Pisetzki a observé pendant plusieurs années l’évolution des musées juifs et des institutions culturelles juives de la zone linguistique alémanique, et en 2021, elle a soutenu sa thèse de doctorat sur leurs représentations internes du judaïsme par opposition aux caractérisations de l’extérieur. Son livre est désormais paru. Naomi Lubrich a parlé avec l’auteure d’un sujet de recherche qui conduit à l’histoire des villages au-delà des frontières nationales.
Naomi Lubrich: Chère Darja, dans ton livre qui vient de paraître, tu as étudié les musées juifs et les institutions culturelles alémaniques. Comment t’est venu ce sujet de recherche?
Darja Pisetzki: Déjà pendant mes études de master, j’ai trouvé intéressante la différence entre les représentations internes du judaïsme et les caractérisations de l’extérieur. C’est la raison pour laquelle j’ai consacré mon travail de master à la genèse des musées juifs en Allemagne après 1945, et en particulier au Musée juif de Berlin. On a reproché au Musée juif de Berlin de ne pas avoir fait participer la Communauté juive de Berlin à l’exposition permanente de 2001, d’avoir par conséquent présenté une vue du judaïsme comme «l’autre judaïsme» et non comme «son propre judaïsme». Après mon master, j’ai voulu traiter ce sujet plus en profondeur. Ce qui m’a particulièrement intéressée, c’est comment et sous quel angle le judaïsme est présenté et transmis dans les autres pays.
NL: Qu’a de particulier la zone linguistique alémanique?
DP: La majeure partie des Juifs allemands vivait au 18e et au début du 19e siècle dans des villages et des petites villes. Malgré l’étendue de la zone linguistique alémanique, et malgré les frontières politiques, les Juives et les Juifs de cet espace culturel étaient liés par la parenté de langue, la pratique religieuse et leurs activités professionnelles. Les musées juifs de cet espace culturel parlent des conditions de vie, des liens entre les différentes communes, et des coutumes culturelles et religieuses du judaïsme alémanique, qui est souvent qualifié de «judaïsme rural».
NL: Ce que les musées juifs présentent comme le judaïsme varie selon le musée. Quelle est la découverte qui t’a le plus surprise?
DP: Ce qui m’a le plus surprise dans les différentes présentations et formes de transmission du judaïsme, c’est qu’il n’y a pas de définition unique de ce que nous désignons aujourd’hui par le terme «judaïsme». Les recherches que j’ai effectuées sur les musées juifs et sur les projets de transmission juifs ont plutôt élargi ma compréhension du judaïsme – des aspects religieux, ethniques, culturels et historiques aux aspects philosophiques et aux questions d’identité.
NL: Les musées juifs, tout comme le nôtre, ont considérablement changé au cours des vingt dernières années. À ton avis, comment vont-ils évoluer au cours des vingt prochaines années?
DP: À une époque où de plus en plus d’informations et de connaissances sont disponibles partout et à tout moment, les musées vont probablement, en particulier dans le domaine des présentations et de la transmission, se transformer à l’avenir, en ce sens qu’ils vont de plus en plus devenir des lieux interactifs de la communication mutuelle. Ceci vaut également pour les musées juifs. Il va être fascinant d’observer comment les musées juifs relieront les aspects historiques et les questions modernes, tout en entrant en dialogue avec leurs visiteuses et visiteurs. Le projet de transmission «Double porte» par exemple a élaboré un concept captivant. Les contenus historiques montrant à quoi pouvait avoir ressemblé la vie juive dans la vallée de Surbtal vont être transmis à l’aide de courts métrages. Les visiteuses et visiteurs pourront décider eux-mêmes en plusieurs étapes quelles sont les questions – concernant notamment la migration, la religion et la civilisation juives ainsi que la cohabitation des juives et des juifs avec les chrétiennes et les chrétiens – qui les intéressent particulièrement, et comment l’histoire racontée à l’aide de scènes cinématographiques doit continuer.
NL: Chère Darja, merci beaucoup pour ces suggestions!
rédigé le 16.09.2022

Cinq questions à
Akiva Weingarten
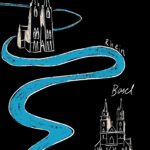
Quatre questions à Christiane Twiehaus