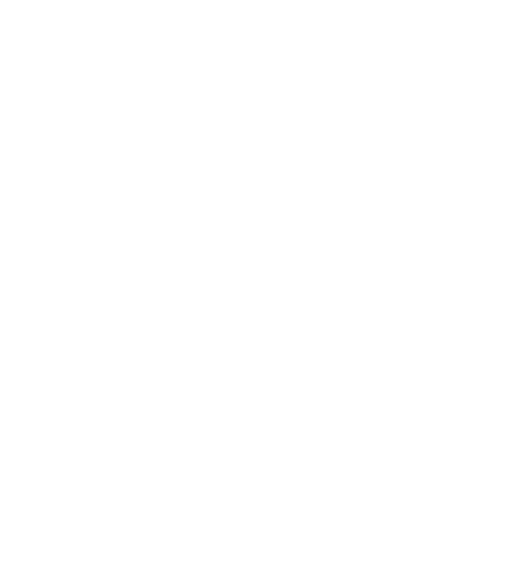«Les mappot sont idéales pour raconter des histoires.»
Sept questions à Dinah Ehrenfreund
Le Musée juif de Suisse conserve des centaines de mappot datant du 17e au 20e siècle. Dans son dernier livre «Geburtskultur. Jüdische Zeugnisse aus der ländlichen Schweiz und dem Umland» (trad. fr.: Culture de la naissance. Témoignages juifs de la Suisse rurale et de ses environs), la curatrice Dinah Ehrenfreund parle de cet inventaire – et de ce que les bandes de tissu nous apprennent sur l’évolution du culte.
Naomi Lubrich: Dinah, tu es experte en mappot. De quoi s’agit-il?
Dinah Ehrenfreund: Les mappot sont des bandes de tissu qui maintiennent le rouleau de la Torah et protègent le parchemin. Fixé par la mappa, le rouleau de la Torah peut être ensuite revêtu d’un manteau et de bijoux en argent. Les mappot sont largement répandues dans les lieux de culte juifs, mais c’est uniquement de l’ashkénaze germanophone que vient la tradition particulière consistant à inscrire sur la bande d’étoffe le nom, la date de naissance et la bénédiction de la liturgie de la circoncision: «Dès qu’il aura été initié à l’alliance, qu’il grandisse pour l’étude de la Torah, pour le mariage et pour les bonnes actions. Amen. Sela.» Les mappot les plus anciennes datent du 16e siècle. La bande de tissu est confectionnée à partir du lange de circoncision: le morceau d’étoffe rectangulaire est découpé en quatre bandes qui sont cousues bout à bout dans le sens de la longueur, couvert d’inscriptions et brodé ou peint – et après un certain temps il est offert en don à la synagogue.
NL: Qui pouvait se permettre de faire don d’une mappa?
DE: Alors que seules quelques familles aisées faisaient don de rideaux de la Torah ou d’ustensiles en argent, il semble que la plupart des familles des communes rurales suisses pouvaient apporter une mappa comme contribution après la naissance d’un fils. Au 19e siècle, les mappot n’étaient pas un présent coûteux. Mais elles représentaient une possibilité de faire un don à la communauté et d’être ainsi immortalisé.
NL: Qui a étudié les mappot suisses, et quelles ont été les constatations?
DE: Florence Guggenheim-Grünberg (1898–1989) a été la première chercheuse après 1945 à étudier systématiquement un inventaire synagogal de mappot. Elle était à l’époque l’experte reconnue en folklore juif de Suisse. Du point de vue actuel, son regard sur le folklore juif était néanmoins nostalgique. Aussi n’a‑t-elle guère prêté attention à la fabrication de mappot en sa présence. Peter Stein compléta toutefois ce dernier point plus tard par une étude sur la fabrication des mappot au 21e siècle, étude qui a montré qu’il y a eu et qu’il y a une culture vivante des mappot.
NL: Les mappot sont réservées aux garçons et aux hommes – les femmes sont-elles également reconnaissables dans les mappot?
DE: Ce ne sont pas seulement tous les actes publics actifs du culte qui sont réservés aux hommes dans le judaïsme orthodoxe, les documents de l’époque prémoderne recensent eux aussi nommément presque exclusivement les hommes en tant que chefs de famille. Les mappot sont les témoignages matériels d’une société masculine. Bien que ce fussent les femmes qui mettaient les enfants au monde et participaient à la confection des mappot, elles ne sont pas citées nommément.
NL: À côté des caractères, on voit souvent aussi des illustrations. Lesquelles?
DE: Le rouleau de la Torah est le motif le plus fréquent sur les mappot. Il illustre leur usage aussi bien pratique que spirituel. La houppa, le dais nuptial, est un symbole qui est également souvent représenté. Sur les mappot du 18e siècle, les signes du zodiaque sont cités et représentés figurativement. Un autre symbole montre un huit couché en forme de serpent, en tant que motif tressé symbolisant la longévité. On le rencontre en Alsace sur les mappot de même que sur les vœux chrétiens pour le baptême, il symbolise l’espoir d’une longue vie. Quant aux bouquets de fleurs, ils symbolisent sous toutes leurs formes l’arbre de vie.
NL: Y a‑t-il une particularité typiquement suisse dans l’inventaire du Musée juif?
DE: Cela dépend du siècle, les mappot du 17e siècle précisément ressemblent beaucoup aux mappot alsaciennes et allemandes. Je peux cependant relever en tant que particularité typiquement suisse un élément de design du milieu du 19e siècle que l’on trouve dans plusieurs communes et collections de Suisse: les lettres s’alignent en l’occurrence ingénieusement dans une écriture gothique alternant avec une écriture moderne semi-cursive. Il convient de noter qu’à partir de 1865, une particularité iconographique vient s’ajouter chez ce «type suisse»: Au-dessus de la date de naissance hébraïque est dessiné un ruban sur lequel sont complétés le nom, la date et le lieu de naissance ou d’origine en caractères latins. Nous avons de surcroît en Suisse la chance de pouvoir identifier également la plupart des personnes en raison des sources historiques supplémentaires qui se trouvent dans les communautés et les archives.
NL: La confection des mappot avait autrefois une plus grande importance qu’aujourd’hui.
DE: Oui, tant pour les individus que pour la communauté. Les inventaires synagogaux de mappot de la Torah comprenaient dans l’idéal tous les hommes d’une communauté sur une longue période. Ils documentaient la communauté, ses membres, sa taille et donc son importance. Disons pour simplifier: plus la communauté conservait de mappot dans l’armoire et plus celles-ci remontaient loin dans le temps, plus grande était son importance. Le fait que la documentation de la naissance a été prise en charge par une autre institution – publique – a conduit dès 1900 à une perte d’importance de la coutume. Aujourd’hui il y a non seulement des familles qui perpétuent la coutume, mais aussi d’autres pour lesquelles elle a une importance moindre ou même qui l’ignorent totalement. En tout cas, les mappot sont idéales pour raconter des histoires intéressantes!
NL: Merci beaucoup pour l’entretien, chère Dinah.
rédigé le 14.02.2023