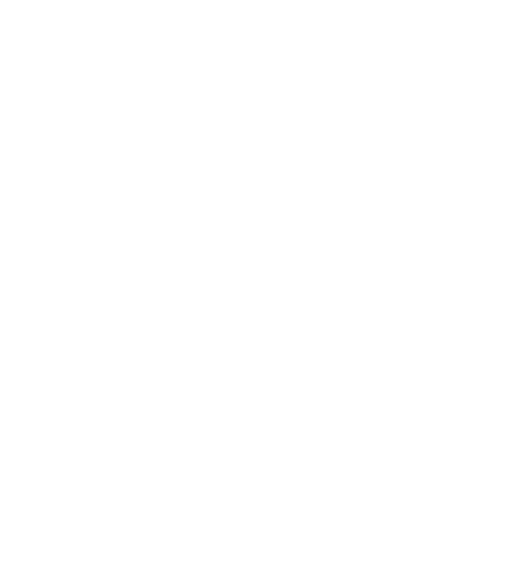Christina Meri avec coupe kiddouch, JMS 45
Christina Meri, Musée juif de Suisse, 2023
Amulettbehälter mit der Inventarnummer 887
Chanukkia mit der Inventarnummer JMS 404
Amulettbehälter mit der Inventarnummer 887
«Les contrefaçons de judaica ont induit la science en erreur.»
Six questions à Christina Meri
Les contrefaçons sont un défi pour toute activité de collecte, pour la nôtre aussi. Les échanges avec d’autres musées juifs jettent depuis quelques années une nouvelle lumière sur les judaica douteux. Christina Meri, la curatrice de la collection, a identifié des objets suspects et parle dans l’interview avec Naomi Lubrich, la directrice du musée, de vis, de poinçons douteux et d’éléments amovibles sortis du temps – ainsi que du commerce mondial avec la nostalgie juive.
Naomi Lubrich: Chère Christina, tu t’intéresses aux faux judaica. Quels sont les différents types?
Christina Meri: Il y a deux catégories de judaica: les contrefaçons et les falsifications qui doivent faire croire aux acheteuses et acheteurs à une authenticité historique, souvent, dans le cas de l’argent, grâce à l’utilisation de faux labels d’argent. Un grand nombre d’alliances détenues par des musées juifs du monde entier sont des contrefaçons qui étaient négociées encore récemment comme bagues italiennes anciennes.
NL: … et les falsifications?
CM: Les falsifications sont des antiquités authentiques qui ont été judaïsées ultérieurement, la plupart du temps par des inscriptions en hébreu. Souvent des sucriers décoratifs ou des porte cure-dents ont été vendus comme boîtes à épices besamim, parce que les judaica sont plus rares et atteignent par conséquent des prix plus élevés. D’autres falsifications sont composées de plusieurs éléments réutilisés. Nous avons un gobelet de kiddouch dont le pied est constitué d’un ancien chandelier. On trouve souvent un label d’argent authentique sur l’un des éléments de ces falsifications.
NL: Comment sont-elles arrivées au Musée juif?
CM: Le commerce de judaica anciens a commencé au 19e siècle, lorsque des collectionneuses et collectionneurs privés ont acquis des judaica esthétiques représentatifs. Parmi ceux-ci se trouvaient aussi de nombreux objets de démonstration pour la vitrine qui n’étaient pas destinés à l’usage. Au tournant du 20e siècle, des comités et des associations de soutien du patrimoine culturel juif ont contribué à la création de musées ou de départements juifs dans les musées d’histoire locale ou d’ethnographie de différentes villes d’Europe. Les ustensiles de culte juifs étaient étudiés sous l’angle de l’ethnologie ou de l’histoire de l’art. Ceci a également entraîné une hausse de la demande de judaica, et l’offre d’antiquités juives anciennes – ou pas si anciennes – s’accrut en conséquence. Dans les premières années de la fondation du musée en 1966, notre collecte a reçu des judaica comme prêts permanents d’autres musées suisses et comme dons de particuliers. Le musée a toutefois aussi acheté des contrefaçons sans le savoir.
NL: Comment vérifie-t-on l’authenticité d’un objet?
CM: Nous étudions la qualité et la finition des objets en les comparant avec d’autres objets de la même époque. Souvent on reconnaît les faux objets en argent aux vis qui ne correspondent pas à l’époque, au filetage et au soudage. De faux poinçons de villes réputées pour leur orfèvrerie sont utilisés pour accroître la valeur d’un objet de la judaica. Si par exemple les marques de la ville et les marques d’orfèvrerie ne correspondent pas, il s’agit d’un faux. Et qualitativement aussi, les contrefacteurs atteignent rarement la qualité des produits de pointe. Dans le cas des compositions, il est utile d’étudier le style des différents éléments. On le reconnaît facilement quand un élément ressemble à du Biedermeier et un autre à du rococo. On démasque les falsifications lorsque les inscriptions gravées contiennent des vices artisanaux ou des fautes d’orthographe. Et en dernier lieu, on peut vérifier si les objets cérémoniaux sont adaptés à l’usage prévu, donc s’ils fonctionnent réellement. Nous avons dans notre collection des récipients de Besamim dont les ouvertures sont tellement étroites qu’on peut à peine y faire entrer des épices et qu’on n’arrive plus à les sortir.
NL: Est-ce que les contrefaçons sont les mêmes dans tous les musées?
CM: Oui, les musées juifs d’Europe du moins ont des contrefaçons similaires, si bien que nous croyons qu’un réseau commun de faussaires a fourni les musées. C’est un travail de détective – qui est très passionnant!
NL: Qu’écrira-t-on sur ces objets dans trente ans?
CM: Les faux ont longtemps induit la science en erreur. Ils ont trouvé leur place dans les catalogues d’œuvres et dans la littérature secondaire. Ils ont façonné notre compréhension de la manière dont les coutumes religieuses étaient célébrées. Les faux judaica de la fin du 19e siècle sont toutefois aussi des documents historiques, l’expression de leur époque. Ils renseignent sur l’état de la recherche à l’époque dans le domaine encore jeune de l’ethnographie juive. Certains reflètent le souhait des Juives et Juifs nouvellement égaux en droits de posséder des témoignages décoratifs, un passé digne de ce nom. Les objets sont représentatifs – ou doivent susciter la nostalgie. Espérons que dans trente ans on comprendra les contrefaçons, qu’on les identifiera clairement et qu’on aura fait la lumière sur leur contexte d’origine.
NL: Chère Christina, espérons que cela ira plus vite! Merci beaucoup de partager tes connaissances avec nous – et les sources ci-dessous:
Vivian B. Mann, The First English Collector of Jewish Wedding Rings and their Dealers, in: IMAGES, Bd. 11, Leiden 2018, 177–185.
Alfred Moldovan, Foolishness, Fakes, and Forgeries in Jewish Art. An Introduction to the Discussion on Judaica Conservation and Collecting Today, in: Clare Moore (Hrsg.), The Visual Dimension. Aspects of Jewish Art, 1. Aufl., Routledge 1993, 105–119.
Bernhard Purin, Judaica in Süddeutschland. Eine Typologie, Kap. 6: Fälschungen, Verfälschungen und Repliken, in: Otto Lohr, Bernhard Purin (Hrsg.), Jüdisches Kulturgut. Erkennen-Bewahren-Vermitteln, Berlin/München 2017, 90–93.
Jay Weinstein, A Collectors’ Guide to Judaica, Kap. 18: Fakes and Forgeries, London 1985.
rédigé le 11.07.2023
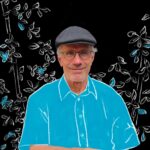
Roger Harmon sur la pierre médiévale datée de Bâle

Barbara Häne sur un album photo datant de l’époque de la guerre en Suisse