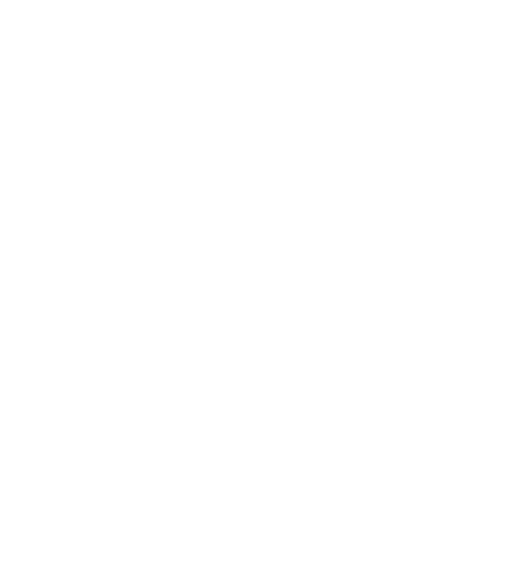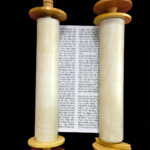«Une curatrice devrait être à la fois introvertie et extrovertie»
Nous présentons Christina Meri
Permettez-nous de présenter Christina Meri. Actuellement responsable de la collection du Musée juif de Grèce à Athènes, elle sera à partir de juillet 2022 la nouvelle curatrice Dr. Katia Guth-Dreyfus du Musée juif de Suisse. Christina Meri travaillera à la recherche et à la conservation de la collection bâloise. Son poste est un legs de Dr. Katia Guth-Dreyfus, la directrice fondatrice du musée. Dans l’entretien avec Naomi Lubrich, elle parle du judaïsme séfarade et ashkénaze et des compétences qui sont nécessaires pour être une bonne curatrice.
NL: Chère Christina, pendant près de vingt ans, tu as été la curatrice du Musée juif de Grèce. Que doit-on savoir sur les judaïca grecs?
CM: En Grèce, on trouve essentiellement des judaïca romaniotes et séfarades. Les communautés romaniotes se sont développées dans l’Empire byzantin à partir des communautés juives de l’époque hellénistique et préromaine. Les Juifs de Byzance parlaient grec et un dialecte unique, le javanais. Jusqu’au 15e siècle, ils formèrent la majorité de la population juive en Grèce. Après l’arrivée des séfarades judéo-espagnols, donc des Juifs expulsés de la péninsule ibérique à la fin du 15e siècle, les Romaniotes furent alors en minorité, tandis que les séfarades jouèrent un rôle important dans la vie sociale et économique des villes. Les traditions séfarades gagnèrent en influence, ce que l’on reconnaît aux objets de cérémonie. Virent aussi le jour des formes hybrides de judaïca uniques en leur genre. En raison de la domination ottomane séculaire, qui s’étendit jusqu’au 20e siècle, on trouve surtout des formes et motifs ottomans sur les objets de cérémonie judéo-grecs.
NL: Existe-t-il des particularités locales, à savoir des traditions que l’on ne rencontre nulle part ailleurs?
CM: Oui! Les Juives et Juifs des communautés romaniotes, surtout à l’ouest de la Grèce, ont conçu des objets que l’on connaît peu sinon, en particulier les chaddayot et les alephiot. Les chaddayot sont des plaques de dédicace en argent décorées, sur lesquelles sont gravées des épitaphes hébraïques, et qui ont été bénies dans la synagogue pendant les cultes de jours de fête en souvenir de proches vivants ou défunts. Les offrandes votives étaient ensuite fixées au rideau de la Torah ou cousues par groupes à des ceintures en tissu, afin d’être accrochées pour les grandes occasions au-dessus des tikkim, c’est-à-dire des récipients en bois de la Torah. Cette coutume romaniote unique est documentée depuis le début du 17e siècle. Quant aux alephiot, il s’agit d’amulettes décoratives de berceau de bébé; en papier et de la taille d’un poster, elles étaient accrochées au-dessus du lit de l’accouchée et de son fils nouveau-né. Sur ces amulettes étaient également inscrits le nom du père et la date de naissance du fils en écriture hébraïque, comprenant bénédictions et prières. Le nom du descendant était ajouté après la circoncision, de sorte que l’alephiot serve au garçon de certificat de circoncision dans sa vie ultérieure.
NL: En Suisse romande, le judaïsme séfarade est très présent, mais dans notre collection, il est encore sous-représenté. Quel objet souhaiterais-tu avoir pour notre musée?
CM: J’aimerais évidemment que nous ayons une collection représentative – et qui sait? Peut-être que nous y parviendrons avec le temps. Ce qui m’intéresserait personnellement, ce serait de faire des recherches sur les séfarades qui, venant des Balkans, de Grèce et de Turquie, ont immigré en Suisse romande au début du 20e siècle. En dehors de la communauté principale de Lausanne, il y avait par exemple depuis environ 1920 une communauté séfarade restreinte, le «Minjan Sephardi», fondée par David Abraham Benjamin de Salonique. L’objet de mes rêves? Un rideau de la Torah datant de l’époque de sa fondation.
NL: Quels sont les judaïca ashkénases que tu trouves d’emblée intéressants?
CM: Pendant de nombreuses années, j’ai étudié principalement les judaïca venant de communautés urbaines grecques et ottomanes. Par contraste, je suis attirée par les anciens objets de cérémonie et du quotidien qui ont appartenu à des Juifs ruraux de Suisse, tels que par exemple les colliers-amulettes (Halsgezeige) et les vêtements portés à la synagogue, qui ont été confectionnés à partir des tissus de robes de fête pour femmes. Je suis impatiente de découvrir – et de transmettre – les traditions et coutumes qui diffèrent d’une région à l’autre et qui sont reflétées dans ces objets.
NL: Qu’attend-on d’une curatrice? Quels traits de caractère doit-elle avoir?
CM: À mon avis, la curatrice d’un musée devrait être à la fois introvertie et extrovertie. Introvertie de sorte qu’elle ait assez de temps et de patience pour laisser agir un objet sur elle et le laisser lui parler, afin de découvrir ses différentes facettes souvent cachées. Cela implique également l’amour du détail et de ce qui est insignifiant en apparence – car ce sont souvent les objets inintéressants à première vue qui nous racontent leur propre histoire. Comme je suis une visuelle et que j’ai de l’affinité pour l’art, ces qualités m’ont aidée à pénétrer dans le monde des judaïca. Une curatrice devrait toutefois aussi être extrovertie. Un musée est fait par les hommes et pour les hommes. Se mettre avec beaucoup de sensibilité au diapason du public, des visiteurs ou de la communauté peut rendre visibles des histoires cachées.
NL: Merci beaucoup, Christina, et bienvenue à Bâle.
rédigé le 20.06.2022