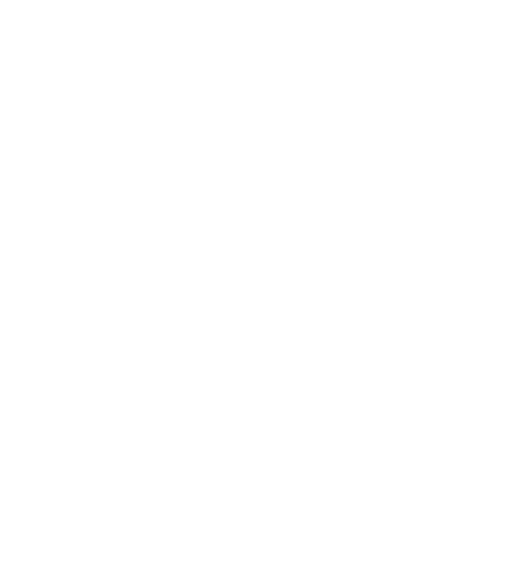«Elle a été une pionnière du dialogue interreligieux.»
Oded Fluss sur
Margarete Susman
À Zurich, les institutions culturelles Omanut et la bibliothèque ICZ célèbrent ce mois-ci la philosophe Margarete Susman qui est née il y a 150 ans. Oded Fluss, conférencier et bibliothécaire de l’ICZ, s’est entretenu avec Naomi Lubrich à propos de cette femme qui a marqué les discussions juives allemandes de l’après-guerre en Suisse.
Naomi Lubrich: Cher Oded, Margarete Susman est née il y a 150 ans. Que faut-il savoir à son sujet?
Oded Fluss: Margarete Susman était une poétesse, philosophe religieuse, penseuse et critique littéraire issue d’une famille juive bourgeoise de Hambourg. En 1933, elle a émigré d’Allemagne vers Zurich où elle a appris le sort des juifs sous le régime nazi, la mort de sa sœur Paula, qui s’est suicidée en 1942 après une tentative de fuite ratée, ainsi que l’assassinat de son amie la plus proche, la poétesse Gertrud Kantorowicz, au camp de concentration de Theresienstadt.
NL: À ses débuts, Susman ne s’est pas intéressée aux thèmes juifs. Qu’est-ce qui a suscité son intérêt pour le judaïsme?
OF: Susman a grandi dans une famille assimilée, dans laquelle le judaïsme ne jouait pas un rôle majeur. Elle connaissait et vivait selon les coutumes de la culture allemande majoritaire. Sa fête préférée était Noël, que sa famille célébrait «selon la tradition allemande». Les histoires et les chansons antisémites pour enfants étaient omniprésentes, si bien qu’elle avait honte de sa propre judéité. C’est au début de la vingtaine qu’elle s’est tournée vers le judaïsme, après la mort de son père. Elle a fait la connaissance du rabbin libéral César Seligmann et en a appris davantage sur ses origines. L’amitié entre Seligmann et Susman est reflétée dans ses écrits philosophiques et dura toute sa vie. Son deuxième tournant vers le judaïsme fut une conséquence de l’Holocauste: juste après la guerre, en 1946, elle publia Le Livre de Job et le destin du peuple juif. Malgré sa perspective juive, ses écrits sont toutefois imprégnés d’idées messianiques et chrétiennes, et ont donc été controversés.
NL: Susman était-elle en avance sur son temps en tant que femme?
OF: En tant que femme, elle fréquentait des cercles qui n’étaient autrefois réservés qu’aux hommes. Elle était par exemple l’une des rares femmes du «cercle de George», dirigé et nommé d’après le poète Stefan George. Elle fut la seule femme être publiée dans le célèbre ouvrage collectif Vom Judentum (publié par l’association Bar Kochba des élèves juifs à Prague en 1913), dans lequel paraissaient également des contributions de Martin Buber, Gustav Landauer, Jakob Wasserman et Karl Wolfskehl. Et elle était la seule autrice de la Schocken Bücherei (à l’exception de Fega Frisch, qui a écrit une courte postface à l’une de ses traductions), qui fut sans doute la plus importante série de livres juifs du XXe siècle.
NL: Comment Susman a‑t-elle fait de Zurich sa nouvelle patrie?
OF: Susman s’est installée à Zurich en 1933, à l’âge de 61 ans, alors qu’elle était déjà une intellectuelle reconnue. Pendant la guerre, elle a dû craindre, comme tous les juifs, la surveillance de la police des étrangers suisse et a été très limitée dans ses activités. Malgré cela, elle était très attachée à la Suisse. Elle l’appelait sa «deuxième patrie». Enfant, elle avait déjà passé de nombreuses années à Zurich. C’est ainsi qu’elle a intitulé un chapitre sur la Suisse dans son Émigration vers la patrie. La langue lui était également sympathique. Pour elle et d’autres juifs, l’allemand était un fardeau. Elle considérait le suisse allemand comme un bon compromis pour éviter la consonance allemande tout en communiquant dans sa langue maternelle. C’est ici qu’elle a écrit ses œuvres les plus importantes.
NL: Quelle était la position de Susman dans le débat germano-juif de l’après-guerre?
OF: Margarete Susman n’a jamais abandonné la culture allemande, même lorsque son pays s’est retourné contre elle. Et elle n’a jamais tourné le dos aux non-juifs. Elle s’est proposée à plusieurs reprises pour bâtir des ponts entre les cultures et les religions: elle était convaincue par l’idée du dialogue interreligieux, bien avant qu’il ne devienne majoritaire. Et elle s’est engagée pour la protection de tous les êtres humains, quelle que soit leur origine. Mais ce qui marquera le plus le souvenir de Margarete Susman, c’est sans doute sa description de Job comme incarnation ultime et universelle de la souffrance humaine.
NL: Merci beaucoup, Oded, pour nous avoir livré ton opinion sur cette femme impressionnante.
rédigé le 03.11.2022

Sascha Schönhaus parle de son père Cioma Schönhaus